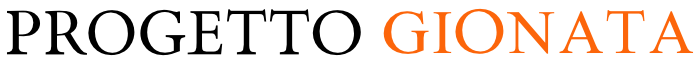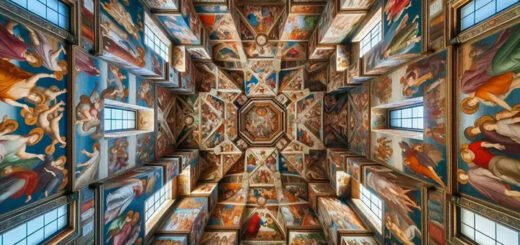Combien de prêtres gays y a-t-il dans l'Église catholique?
Article de Josselin Tricou * publié dans le magazineSociologies(France), 2018/2 (Vol. 9), pp. 131-150, traduit librement par Giacomo Tessaro,huitième
Comme James G. Wolf l'a fait pour les États-Unis, Julien Potel a tenté de faire une estimation du pourcentage de prêtres homosexuels en France, en ce qui concerne ce que j'appellerai, pour plus de commodité, une vocation "Cachette". Il est significatif que Potel, qui, en plus d'être sociologue, soit un prêtre, n'a jamais publié les résultats de ses recherches.
Face à l’impossibilité d’une recherche ouverte et systématique, Wolf et Potel ont eu recours à une méthode indirecte : demander aux prêtres homosexuels qu’ils ont interrogés une estimation du pourcentage de leurs frères homosexuels. Les deux auteurs les estiment à un pourcentage compris entre 30 % et 70 %. Par exemple, un échantillon d'une centaine de prêtres interrogés par Wolf estime ce pourcentage aux États-Unis à environ 48 %, et à environ 55 % pour les séminaristes.
Bien que Wolf lui-même reconnaisse que ces données ne sont pas fiables à l’heure actuelle, une comparaison entre les générations (en ce qui concerne l’âge des prêtres interrogés) montre une augmentation significative du pourcentage parmi les prêtres les plus jeunes. Peut-être l’effet d’une plus grande prise de conscience parmi les jeunes générations de prêtres homosexuels ? Ou est-ce dû à une plus grande visibilité, ou peut-être y a-t-il réellement plus de prêtres homosexuels aujourd’hui ? En tout cas, certains, comme le Père Donald Cozzens (vicaire épiscopal américain diplômé en psychologie), n'hésitent pas à diagnostiquer un véritable « crise de l’orientation [sexuelle] » dans le clergé catholique d'aujourd'hui.
En France, l'effondrement du recrutement traditionnel des prêtres à la campagne, qui a été effectué dans des séminaires mineurs (les instituts qui, avant l'introduction des écoles secondaires en 1963, étaient fondamentaux dans la scolarité des enfants généralement de familles rurales pauvres, dans le but de stimuler la vocation sacerdotale), suivi de l'abandon d'un grand nombre de prêtres hétérosexuels qui se sont ensuite mariés, pendant le "Crise catholique" des années 70, il est sans aucun doute à l'origine d'un manque de vocations "qualité"et un grand nombre de vocations "Cachette".
Si nous considérons également la baisse du recrutement entre la vieille bourgeoisie conservatrice (dont les enfants ont des alternatives rares s'ils admettent avec eux-mêmes qu'ils sont gays), il devient clair que cette concentration a augmenté le nombre de vocations "Cachette".
Un interlocuteur commente: «En parlant en général, il y a eu un changement depuis les années 70, lorsque le clergé était largement hétérosexuel et à gauche, dans les années 2000, lorsque de nombreux prêtres homosexuels et droits ont émergé. En fait, plus l'Église a développé sa rhétorique homophobe, plus les homosexuels qui ont nié l'être, au moins au début de leur carrière " (Père Arthur, prêtre travailleur, 67 ans).
Mais désormais, avec l’émergence de la masculinité gay dans les sociétés laïques contemporaines (affirmation socioculturelle et reconnaissance du mariage homosexuel), que va devenir le recrutement des prêtres ? Les membres du clergé les plus perspicaces ne peuvent s’empêcher d’entrevoir une double menace.
A court terme, les séminaires risquent de se transformer en lieux où l'homosexualité est trop visible, et à l'instar des monastères dits américains « gay-friendly », des milieux hautement homoérotiques accusés d'exclure les candidats hétérosexuels.
Mais à long terme, la menace est la vidange des séminaires déjà largement désertés et la cessation du rôle de l'Église en tant que cachette sûre, cachette si bien décrite par Mgr Charamsa. au début de la première partie de cette série.
D'où la nécessité actuelle (selon le titre d'un atelier du colloque annuel sur les vocations de la Conférence épiscopale française, tenu à Paris le 23 janvier 2014) de « rejustifier et réévaluer le célibat consacré dans la société contemporaine », mais aussi, et peut-être surtout, la nécessité de réactiver (dans une époque qui voit son emprise s'affaiblir) la pression exercée sur les prêtres pour qu'ils ne manifestent pas leur (homo)sexualité, ou du moins se fassent discrets.
Cette politique de "ne dis pas", de ne pas jouer, doit être compris non pas tant que l'effet de la répression institutionnelle des prêtres déviés sexuellement (qui en fait est rarement effectué, malgré le fait qu'il existe des moyens légaux pour le faire), autant que la capacité de silence [prêtres homosexuels, ou en tout cas sexuellement actifs] par l'auto-centrage, pour préserver la ligne détenue par l'Église et le consentement entre les laïcs, dont ils sont responsables.
L'Église reconnaît (voir le concept de pardon, en général et dans le sacrement de la confession) que ses règles sont constamment constituées d'idéaux qui ne peuvent jamais être pleinement expérimentés, également (et peut-être en particulier) par ses prêtres. Dans l'église, la déviance la plus grave n'est pas la transgression de ces règles ("Le catholicisme est généralement flexible" En ce qui concerne les actes accomplis, comme le prétend Céline Béraud), mais la discussion publique de leur légitimité.
En tout cas, le besoin de ne pas provoquer de scandale entre les laïcs est bien intériorisé par les prêtres, gays et hétéros, et est l'un des facteurs qui les poussent à rester dans l'institution, peut-être au prix de la vie double. Étant donné le coût excessif d'une défection visible et irréversible, la solution de la double durée de vie est souvent choisie, malgré la souffrance qu'elle cause.
«Je ne pouvais pas abandonner l'église. Il y avait mon partenaire, et certains collègues le savaient, même si je n'avais jamais essayé de le montrer, ni pour lui demander une position officielle, car il était hors de question que je pouvais endommager l'église avec cette histoire. Mais aujourd'hui, je pense d'une manière légèrement différente. " (Père Michel, curé, 63 ans)
«Écoutez-moi, vous deviez être discret, même si ce n'était pas facile. Vous ne pouviez pas afficher sa sexualité en public, parce que ce n'était pas seulement votre sexualité, et aussi parce que lorsqu'un prêtre parle, il le fait non seulement au nom de lui-même, mais de l'église, une institution qui a déjà été suffisamment affaiblie. Et puis il y a le peuple de Dieu, les paroissiens, que diraient-ils? Ils ne comprendraient pas, et même s'ils comprenaient, je sais que les choquant ne pourraient pas utiliser quelque chose de bien, en effet, le contraire. (Père Arthur, prêtre travailleur, 67 ans)
Texte original :Recréer des «taupes»: gérer le silence des prêtres homosexuels à une époque de mariage gay